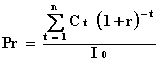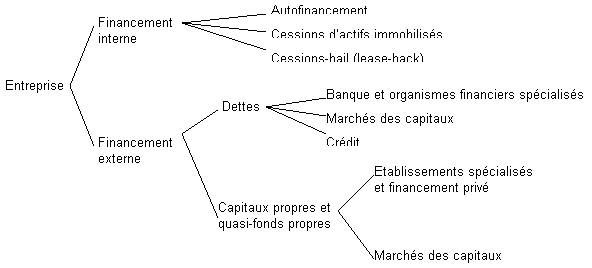|
UNIVERSITE
DE SFAX Ecole
Supérieure de Commerce Enseignant : Walid KHOUFI
Source : A. Boyer, G. Hirigoyen, J. Thépot, N. Tournois et J.-P. Védrine, Panorama de la gestion, Les éditions d’organisation, 2001.
La politique financière concrétise le passage de la théorie à la pratique ou encore le passage des intentions aux décisions. Elle peut se définir comme le choix des conditions financières de l’adaptation de l’entreprise à son environnement. Elle va s’exprimer d’une triple manière :
La politique d’investissement et la politique de financement font référence toutefois à la notion de coût du capital.
1. La politique d’investissement La politique d’investissement est étroitement intégrée à la politique générale et à la politique financière de l’entreprise. C’est pour cela qu’après avoir situé la décision d’investissement dans le cadre de la politique générale de l’entreprise, on étudiera ses aspects financiers. 1.1. Investissements et politique générale de l’entreprise La décision d’investissement est l’affectation de monnaie à un emploi à long terme, c’est-à-dire la création d’un actif physique ou financier qui participe à un cycle financier long. Cette décision est grave parce que généralement irréversible et parce qu’elle engage l’entreprise sur une longue période. C’est pour cela que la politique d’investissement doit être en conformité avec la politique générale de l’entreprise. «Bien que la désirabilité de chaque dépense particulière de capital doive être définie «par les bénéfices» qu’elle promet, elle doit aussi être jugée d’après sa compatibilité avec le programme d’ensemble». La politique générale doit permettre d’apprécier l’opportunité des décisions d’investir car «très souvent dans un premier tour, c’est moins leur rentabilité financière immédiate qui compte que la réalisation de l’objectif fonctionnel qu’on leur a imputé». (Labrousse). Les investissements requis par la mise en oeuvre de la politique générale peuvent être internes, externes ou semi-externes à l’entreprise :
L’entreprise ne peut décider d’une politique de croissance, de réorganisation, de diversification ou de recentrage qu’après avoir effectué une étude approfondie de la concurrence et des marchés de chacun de ses produits. Elle peut le faire à partir des méthodes d’analyse stratégique de la politique financière comme par exemple la matrice d’Arthur D. LITTLE représentée ci-après :
Cette esquisse d’analyse stratégique de la politique d’investissement montre que le choix des investissements dépasse le cadre strictement financier. Il n’en demeure pas moins que la rentabilité à long terme demeure l’objectif essentiel de toute politique d’investissement. 1.2. Aspects financiers de la politique d’investissement La décision d’investissement est une décision financière dans la mesure où la réalisation de l’investissement implique son financement et donc une immobilisation de fonds dans l’espoir de l’obtention d’une bonne rentabilité. L’investissement doit donc obéir à un objectif de rentabilité. Mais dans un environnement d’incertitude il doit répondre aussi à un objectif de flexibilité. 1.2.1. L’objectif de rentabilité Financièrement, l’investissement se caractérise par une sortie de fonds initiale (le capital investi) et des rentrées de fonds(cash-flows ou flux nets de liquidité) échelonnés sur toute sa durée de vie. L’investissement est acceptable dans la mesure où les gains attendus sont supérieurs au capital investi. Evaluer un projet d’investissement consiste donc à comparer ces deux éléments : gains attendus (cash-flows générés par le projet) et capital investi. Plusieurs critères d’évaluation des projets d’investissement existent : valeur actuelle nette, indice de profitabilité, taux de rendement interne.
Pour que le projet Soit acceptable, il faut que la VAN soit positive. Entre plusieurs projets on retient celui qui a la plus grande VAN. Le taux d’actualisation utilisé est le taux de rentabilité minimum exigé par l’entreprise. Théoriquement ce taux représente le coût du capital de l’entreprise (voir 3. le coût du capital).
Le projet sera jugé rentable si son indice de profitabilité est supérieur à 1. Le projet le plus intéressant est celui qui a le plus fort indice de profitabilité.
Le T.R.I. correspond au taux d’actualisation qui annule la VAN. Le projet d’investissement sera jugé acceptable si son T.R.I. est supérieur au taux de rentabilité minimum exigé par l’entreprise. Le T.R.I. représente donc le coût maximum du capital susceptible de financer l’investissement. Entre plusieurs projets, on retient celui qui a le plus fort T.R.I. Ces critères de choix obéissant à un objectif de rentabilité peuvent céder la place dans un environnement incertain au critère du délai de récupération du capital investi (ou pay-back period) qui est le temps au bout duquel le montant cumulé des cash-flows actualisés est égal au capital investi. Le choix entre plusieurs projets s’effectue alors sur la base du délai de récupération le plus court. Ces différents critères ne tiennent pas compte toutefois de l’objectif de flexibilité. 1.2.2. L’objectif de flexibilité Ignorer la flexibilité d’un projet revient à négliger les capacités de raisonnement et de décision des dirigeants de l’entreprise. Tout décideur compétent modifiera le déroulement de son projet à mesure que le temps passe et que de l’information nouvelle surgit. Cette flexibilité s’exprime fréquemment en termes d’options :
L’incorporation de ces options dans l’évaluation des investissements a conduit à un nouveau critère : la valeur actuelle nette augmentée (VANA). Celle-ci se définit comme étant égale à la somme de la VAN classique plus la valeur des options attachées au projet. VANA = VAN (classique) + Valeur des options attachées au projet.
2. La politique de financement Elle pose la double question de l’alternative de financement (interne ou externe) et du choix d’une structure financière. 2.1 . L’alternative du financement L’entreprise se trouve confrontée à une double alternative de financement : elle a tout d’abord à choisir entre le financement interne et le financement externe; puis à l’intérieur de ce second mode entre dettes et capitaux propres. Enfin, lorsque le choix du financement externe se fait, l’entreprise peut s’adresser au circuit bancaire, aux établissements financiers spécialisés, à des partenaires industriels et commerciaux, ou encore faire appel aux marchés de capitaux. Il convient de remarquer que les aspects fiscaux jouent un rôle non négligeable dans l’alternative de financement. Le schéma ci-après résume les différents termes de ces alternatives de financement :
Schéma 2 : Les alternatives du financement dans l’entreprise 2.1.1. Le financement interne Le financement interne de l’entreprise a trois origines possibles :
- du renouvellement normal des immobilisations qui s’accompagne chaque fois que cela est possible, de la vente des biens renouvelés; - de la vente de certains actifs hors-exploitation (terrains, sièges sociaux...); - de la mise en oeuvre d’une stratégie de recentrage : l’entreprise cède alors des participations, des filiales...
et sa capacité de remboursement mesurée par le ratio :
Le financement interne est toutefois rarement suffisant à financer la croissance de la firme, qui est amenée à faire appel au financement externe. 2.1.2. Le financement externe Deux solutions sont envisageables : recourir à l’endettement ou faire appel aux capitaux propres ou aux quasi-fonds propres.
Les capitaux propres externes proviennent bien entendu tout d’abord d’un apport de fonds sous forme de capital au sens strict Les apporteurs de capitaux propres reçoivent en échange de leur apport des actions. L’action est un titre de participation qui confère à son possesseur la qualité d’associé et lui donne droit à une part proportionnelle des bénéfices distribués par la société. Elle lui donne aussi un droit de contrôle sur la gestion de l’entreprise qui s’exerce par le droit de vote. Une entreprise souhaitant faire appel public à l’épargne, notamment dans le cas d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles, peut recourir au marché des actions. Elle a la possibilité d’être cotée sur trois marchés le marché officiel (ou cote officielle), le second marché et le « nouveau marché » destiné à accueillir les jeunes sociétés innovantes. Les capitaux propres externes proviennent aussi de certaines primes, ainsi que tout ou partie de certaines subventions dans la mesure ou elles restent définitivement acquises à l’entreprise. Depuis la fin des années 70 on assiste au développement constant des quasi-fonds propres. Trois lois fondamentales ont joué un rôle essentiel dans ce domaine la première loi, celle du 13 juillet 1978, a assimilé les prêts participatifs à des capitaux propres. La deuxième, la loi du 3 janvier 1983 permet la création de titres hybrides, entre capitaux propres et dettes. Ainsi viennent se ranger aux côtés des obligations convertibles en actions introduites dans le droit français par la loi du 6 janvier 1969, les certificats d’investissement, les titres participatifs, les obligations à bons de souscription d’actions. La troisième loi, du 14 décembre 1985, n’est pas moins importante. Elle introduit d’une part, les titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) qui sont assimilables à des fonds propres lorsqu’ils ne sont pas amortissables et offre d’autre part, la possibilité aux entreprises de dessiner elles-mêmes la configuration des produits financiers qu’elles veulent émettre. Le prêt-à-porter financier a laissé place au sur-mesure et les entreprises ont rivalisé d’imagination dans leur recherche de titres permettant d’accroître leurs fonds propres des bons de souscription d’actions ou de certificats d’investissements ont ainsi été attachés à des obligations convertibles ou remboursables en actions, ou encore à des certificats d’investissements.
Le financement externe par endettement peut revêtir des formes très diverses. Par souci de simplification, nous en distinguerons quatre grandes catégories l’endettement bancaire, les emprunts auprès du public (emprunts-obligations), le recours au crédit-bail et le crédit inter-entreprises. * L’endettement bancaire Les banques proposent à l’heure actuelle une large gamme de concours. Parmi ceux-ci, il convient de citer le prêt, les lignes de crédit, les « Multiple Options Facilitees » (MOF) qui sont des lignes de crédit confirmées assorties d’options de financement comme par exemple des avances bancaires en francs ou en devises, des émissions de billets de trésorerie, des tirages à très court terme. Parmi les crédits de trésorerie on distingue les concours destinés au financement des créances clients (escompte, crédit de mobilisation des créances commerciales), les billets financiers et les avances en compte (facilité de caisse, découvert). Les crédits à long terme sont essentiellement le fait d’organismes spécialisés notamment le Crédit National et le Crédit d’Equipement des Petites et Moyennes Entreprises. * Les emprunts-obligations Seules les sociétés de capitaux peuvent émettre des obligations, c’est-à-dire des titres de créance, au porteur ou nominatif, dématérialisés, donnant lieu au paiement d’intérêts et ne conférant aucun droit de regard sur la gestion de l’entreprise. Le marché obligataire a connu depuis le début des années 80 une croissance sans précédent, à la fois en volume et en qualité. Les innovations concernant les titres offerts ont été très nombreuses et imaginatives, dans les types de rémunération (taux fixe, taux variable, taux révisable), dans la durée et le mode d’amortissement (remboursement in fine, obligations prorogeables, à fenêtres). Ou encore par l’intermédiaire de clauses particulières (bons de souscription d’obligations, bons d’échange, démembrement des obligations, obligations subordonnées). * Le crédit-bail Il peut être mobilier ou immobilier. il autorise un financement à 100 % des biens considérés, il n’affecte pas la capacité d’emprunt de l’entreprise et constitue une sorte d’assurance contre le risque technologique. * Le crédit inter-entreprises Il est particulièrement important en France. il diminue d’autant les besoins de financement bancaire. Pour une entreprise le crédit inter-entreprises représente un apport net de ressources si le montant des crédits consentis à ses clients est inférieur à celui accordé par ses fournisseurs. Dans le cas inverse, le crédit inter-entreprises diminue les ressources de l’entreprise. 2.1.3. La hiérarchie du financement La théorie financière moderne suggère que les entreprises privilégient une hiérarchie au choix de leurs moyens de financement L’approche proposée par MYERS est la suivante :
2.2. Le choix d’une structure financière L’entreprise dispose, pour son financement, d’une gamme élevée d’instruments dont les caractéristiques diffèrent. Le choix qu’elle effectue s’opère principalement entre dettes et capitaux propres. La question principale à résoudre étant celle de savoir jusqu’où l’entreprise peut-elle et est-elle incitée à s’endetter ? Cette question a fait l’objet d’une controverse théorique depuis le début des années 50. Les tenants de l’existence d’une structure financière optimale se trouvaient confrontés à ceux qui défendaient l’indifférence de la valeur de la firme par rapport à son degré d’endettement. La fameuse proposition de MODIGLIANI et MILLER, selon laquelle la valeur d’une entreprise est indépendante de sa structure financière, résulte d’une démonstration rigoureuse. Elle s’appuie sur un raisonnement par arbitrage et des hypothèses fortes : absence de frais de transactions, d’impôts sur les bénéfices et sur les dividendes et de risque sur la dette, ainsi qu’absence d’asymétrie d’information entre les personnes à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises. L’absence de fiscalité est un élément décisif du raisonnement car c’est elle qui rend possible la substitution parfaite de la dette des actionnaires à celle de la société, ce qui permet à ceux-ci d’être indifférents à la structure du capital de l’entreprise. En revanche, en présence d’impôts qui autorisent la déductibilité des intérêts et amputent les dividendes reçus par les actionnaires, l’entreprise aurait toujours intérêt à s’endetter. Dans ce cas, la valeur de la firme est une fonction croissante de son niveau d’endettement. Cette position a toutefois été nuancée par la prise en compte des coûts de faillite. Au-delà du ratio optimal d’endettement, les coûts de faillite dépassent l’économie d’impôt, il vaut mieux cesser de recourir à l’endettement. La théorie financière moderne a également abordé le problème du choix d’une structure financière. Les modèles se référant à la théorie du signal, indiquent que les dirigeants de la firme signalent sa qualité au travers de la structure financière adoptée : la valeur de l’entreprise dépend du niveau d’endettement retenu. Les auteurs de la théorie de l’agence modélisent une firme dans laquelle les dirigeants détiennent une fraction non négligeable du capital. Ils mettent en évidence une structure financière optimale de la firme, résultant de deux incitations divergentes. D’une part, en présence d’impôt sur les bénéfices, les firmes ont intérêt à émettre des dettes, car les charges financières qu’elles génèrent sont déductibles du résultat imposable : la valeur de la firme croît ainsi avec le degré d’endettement. Mais en contrepartie, l’émission de dettes entraîne la naissance de coûts d’agence. Les firmes vont alors s’endetter jusqu’au point où l’accroissement de leur valeur due aux investissements ainsi financés sera égal aux coûts d’agence marginaux générés par un surcroît d’endettement. Ces modèles ont donné lieu à de nombreuses extensions et perfectionnements qui laissent largement ouverte la discussion autour de la structure financière optimale des firmes.
3. Le coût du capital Le calcul du coût du capital d’une société peut être effectué pour plusieurs raisons. il permet l’étude du coût des diverses sources de fonds et la détermination d’une stratégie de financement, il est utile pour le choix d’une structure du capital. Mais son rôle essentiel est surtout lié au choix des investissements. Le coût du capital intervient dans les calculs de rentabilité fondés sur l’actualisation. S’il ne s’insère pas de la même manière dans chacune des trois méthodes, il y traduit néanmoins une exigence commune. Le taux choisi traduit le rendement minimum exigé et joue le rôle de taux de rejet puisqu’il permet d’écarter les investissements dont la rentabilité n’est pas suffisante : accepter ces investissements insuffisamment rentables aurait pour effet de diminuer le bénéfice, par action et nuirait à l’objectif financier. En théorie, le coût du capital est égal au taux interne de rentabilité qui maintiendrait inchangé le cours de l’action. Avant d’étudier le coût global du capital, il convient de déterminer le coût de ses différentes composantes. 3.1. Coût des différentes sources de fonds Les sources de financement peuvent se classer en deux catégories selon qu’elles ont un coût explicite ou un coût implicite. 3.1.1. Coûts explicites On dit qu’une source de financement a un coût explicite lorsqu’il lui correspond des flux monétaires positifs et négatifs effectifs. De
manière générale, le coût explicite d’une source de financement peut
être défini comme le taux actuariel qui égalise les fonds perçus aux
fonds versés à des fins de remboursement ou de rémunération. Ainsi, si
S est une somme mise à la disposition de l’entreprise et si Rt représente
les versements annuels nets de l’entreprise (charges de remboursement
plus frais financiers nets (économie d’impôts déduites des rémunérations).
Le coût de S est défini par le taux k tel que :
C’est
donc le
taux de rentabilité interne pour l’agent qui finance.
*
Coût de la dette bancaire : Soit
une dette de montant D et de taux d’intérêt i. Soit t
le taux d’imposition. Le capital est remboursé intégralement au bout
de N années. Le coût kd est tel que :
On
montre facilement que kd = i(1 - t).
* Coût d’une émission d’obligation
avec prime amortissable linéairement : Soit
p
la prime d’émission amortissable sur N années, E le montant de
l’emprunt. Le coût de cette source kE est tel que :
Il
découle que le coût réel de la dette (ou taux actuariel de revient) est
différent du taux contractuel (ou facial ou nominal), pour diverses
raisons : -
les frais initiaux qui comprennent les commissions bancaires de direction,
de placement, de garantie, les frais de publicité financière,
d’impression de titres et de note d’émission... L’ensemble
atteignant environ 3,5% à 4% du montant de l’emprunt. L’impact
de ces frais sur le taux réel est important car ils sont supportés à
l’origine et ne bénéficient pas de l’actualisation; -
les primes d’émission et primes de remboursement; -
la date de jouissance qui est la date à partir de laquelle courent les
intérêts. Elle peut être antérieure ou postérieure à la date de
mise à disposition des fonds. Une date antérieure augmente le coût
actuariel alors qu’une date postérieure le réduit; -
les frais annuels qui incluent notamment la commission de gestion
payée à la banque chef de file d’une émission pour la gestion des
titres, tenue des registres des assemblées d’obligataires la commission
de paiement de coupons, de remboursement de titres ; le différé
d’amortissement ou différé de remboursement.
*
Coût de l’action émise La
définition de ce coût est celle qui a alimenté toute la controverse théorique
sur le coût de capital. En appliquant cependant la définition précédente
au calcul de ce coût, on peut dire que si un investisseur accepte
d’acquérir des actions d’une société, c’est paire qu’il en
attend une rémunération annuelle sous forme de dividende ou une rémunération
lors de la cession des titres, c’est-à-dire une plus-value, ou par les
deux. Ainsi,
si un investisseur acceptait de mettre S francs dans une société patte
qu’il escompterait recevoir un dividende annuel de D francs et revendre
l’action avec une plus-value de DS
francs dans n années, le coût de l’action pour l’entreprise serait défini
par le taux tel que :
soit
:
Cette
définition est claire, mais, si toute une controverse s’est développée,
c’est parce que les anticipations des actionnaires ne peuvent être
clairement précisées ni en valeur, ni dans le temps, ni en nature. Si
les actionnaires acceptaient de mettre une somme S à la disposition
d’une société en espérant en retirer des dividendes Dt
chaque année i jusqu’à une période infinie, le coût de S serait défini
par l’expression :
et
égal à (sommation de la progression géométrique)
Si
on supposait que ces actionnaires attendent un dividende annuel qui partant
de D0 Croîtrait annuellement à un taux composé g pour mettre
une somme S à la disposition de la société, le coût de S serait défini
par l’expression :
et
égal
*
Coût du crédit-bail Le
crédit-bail peut être assimilé à un emprunt hypothécaire. Le
locataire doit payer une somme fixe chaque année, comme pour un emprunt
mais il s’agit, juridiquement et fiscalement, d’un loyer intégralement
déductible, sans que l’entreprise puisse amortir fiscalement
l’immobilisation concernée, puisque Celle-ci reste la propriété de la
société de crédit-bail.
C0
= valeur de l’investissement financé t
= taux
d’impôt sur les sociétés Lt
= montant du loyer de l’année t At
= montant de l’amortissement au cours de l’année t Rn
= valeur de rachat en fin de contrat Kc
=coût du crédit-bail 3.1.2.
Coûts implicites ou coûts d’opportunité Le
coût
d’opportunité pour un actionnaire est la rentabilité qu’il pourrait
obtenir en investissant dans une autre entreprise de risque équivalent,
c’est-à-dire kp. C’est le coût de l’emploi alternatif. Le
coût de l’autofinancement (au sens du coût du capital correspondant à
cette source, et non pas au sens du coût de la source) est donc égal à
kp (si l’on fait abstraction des impôts et frais de
transaction sur achats d’actions). En effet, si l’entreprise finance
des investissements dont la rentabilité est inférieure à kp,
le prix de l’action baisse. Par conséquent kp est le coût
de l’autofinancement. En
fait, le coût d’opportunité des actionnaires pour les flux
correspondant à l’autofinancement est inférieur à kp. Car
si ces flux étaient versés sous forme de dividendes puis réinvestis
dans une autre entreprise, la rentabilité nette pour l’actionnaire
serait : kp
(1 - T) ( 1-B) où
T est le taux d’imposition des actionnaires, compte tenu de l’avoir
fiscal. B
est le taux des frais de transaction. 3.2.
Coût moyen pondéré 3.2.1.
Principe Le
coût du capital est obtenu en pondérant les coûts des différentes
sources de financement par leur ratio dans la structure des capitaux
permanents, soit :
Ainsi,
dans une société possédant 40 % d’endettement à 10 % net et 60% de
capitaux propres à rémunérer à 20%, le coût du capital de
l’ensemble de la société serait égal à : 0,4 x 10% + 0,6 x 20% = 16% Les
coûts des différentes sources ne sont pas constants. Ils dépendent de
la structure du capital, de la conjoncture sur les marchés financiers et
des montants élémentaires de financement. Pour
les financements petits, le coût pondéré total est un coût marginal.
Si l’on peut calculer le coût pondéré total marginal en fonction du
montant total du financement (en supposant par exemple les proportions des
différentes sources constantes), on pourra déterminer le montant des
investissements comme celui correspondant à l’intersection des
courbes taux de rentabilité marginal, coût pondéré total marginal.
Graphique
1 : La détermination du montant des investissements en fonction des
courbes de taux de
rentabilité marginale et du coût pondéré total marginal 3.2.2.
Difficultés Deux
sources de difficultés
1)
Faut-il utiliser la structure comptable ou la
structure boursière du capital
? Théoriquement, on
raisonne en termes d’anticipations ou de bénéfices futurs rémunérant
l’achat d’une action. Si on veut rester cohérent, il faudrait
utiliser comme coefficient de pondération les valeurs de marché. Soit
par exemple une société ayant émis 100 000 actions d’une valeur comptable
de 10 F ( 5 F de nominal + 5
F de réserves), d’une valeur boursière de 20 F et ayant un coût
du capital A de 10 % et qui aurait par ailleurs émis un emprunt
obligataire de 40000 obligations de 20 F coûtant 5% et cotées 15
F; elle aurait un coût du capital évalué à la valeur boursière de :
Les
limites des deux méthodes sont évidentes. La
valeur de marché est sujette à des variations boursières aléatoires et
ne se justifierait pas pour l’emprunt obligataire puisque celui-ci doit
être remboursé au nominal ou à un prix fixé qui représente la vraie
charge de la société. De plus, la valeur de marché des fonds propres
n’existe pas réellement pour les nombreuses sociétés non cotées et
pour les dettes non obligataires. La
valeur comptable au contraire, même si elle est relativement fixe, ne
représente souvent aucunement les fonds propres mis à la disposition de
la société et les sous-estime presque toujours. Il
est difficile de suggérer une solution, cependant une capitalisation fondée
sur la valeur de marché pour les fonds propres et la valeur comptable de
l’endettement peut souvent être valable. 2)
Faut-il utiliser la structure du capital existante ou la structure du
capital future ? Le problème se pose particulièrement lorsqu’une société
veut modifier la structure de son capital. Le coût des fonds est en général
fondé sur la structure du capital existante. Les banquiers prêtent de
l’argent en fonction de celle-ci. Si la société change de structure,
le banquier peut changer de taux et l’actionnaire modifier ses espérances
de revenu en fonction d’une structure financière de risque différent.
La structure financière future déterminant les coûts futurs et les
nouvelles anticipations des actionnaires, c’est elle qui doit déterminer
les rentabilités des investissements. Il faut noter que le problème est
d’autant plus difficile que les structures du capital varient par palier
et oscillent parce que le financement se fait par blocs d’émissions
d’actions et d’emprunts. L’ensemble
de cette analyse du coût du capital prouve qu’il n’est pas simple de
rendre le concept opérationnel malgré son importance cruciale pour le
choix des investissements. La réflexion pratique sur les sociétés concrètes
doit cependant toujours être tentée parce qu’elle permet de poser les
problèmes fondamentaux du financement et du choix des investissements
d’une société. 4.
La
politique de dividende La
politique de dividende que les entreprises devraient suivre est au cœur
d’un vieux débat théorique : celui de savoir si les dividendes versés
ont un impact ou non sur le cours des actions et la valeur de la firme. Historiquement,
deux grands courants de pensée se sont affrontés dans ce domaine, celui
de la neutralité de la politique de dividendes, c’est-à-dire
l’absence d’influence sur le cours boursier ; celui de la
non-neutralité qui soutient que la valeur des actions est déterminée
ou, en tous cas, influencée par les dividendes. La question de la
distribution des dividendes est toujours actuelle et la théorie financière
moderne lui accorde à travers la théorie du signal et la théorie de
l’agence une place importante quant au rôle qu’ils peuvent jouer dans
la conduite des affaires. En
pratique, les entreprises ont en général une politique de dividende qui
s’établit à partir de plusieurs considérations. 4.1.
Aspects
théoriques 4.1.1.
La thèse de la neutralité Elle
est dominée par les travaux
de MODIGLLANI et MILLER pour
qui le dividende n’aurait aucun impact sur la valeur des actions, et
la politique de dividende ne serait qu’une décision résiduelle. Elle
n’a aucune importance dans la réalisation des performances financières
de l’entreprise. Ce qui influence la valeur de l’action, ce n’est
pas le bénéfice réalisé mais la rentabilité attendue de
l’investissement. Les
thèses qui vont à l’encontre de la théorie de la neutralité,
prennent surtout en considération l’effet de l’incertitude sur le
comportement des épargnants. Un revenu certain et immédiat ne signifie
pas la même chose pour l’actionnaire qu’une plus-value à terme. Le
rendement attendu des investissements est entaché d’incertitude. Des
arguments de nature psychologique ont été également pris en compte,
notamment à travers la théorie de la clientèle qui repose sur la
constatation que les investisseurs n’ont pas tous la même attitude face
au placement, certains recherchant un revenu régulier, d’autres préfèrent
un placement spéculatif. 4.1.2.
Le dividende comme signal de communication financière Le
dividende joue un rôle de signal quant aux perspectives sur les bénéfices
et les cash-flows que les dirigeants des sociétés concernées sont les
mieux à même d’apprécier. Les
changements dans la politique de distribution de dividendes sont au cœur
de la politique d’information financière et constituent l’un des
moyens qu’ont les dirigeants de transmettre de l’information aux opérateurs
sur le marché financier, qui sont moins informés, sans trop dévoiler
leurs projets à leurs concurrents. Les investisseurs feront monter les
cours des sociétés qui augmentent leurs dividendes, et baisser ceux des
sociétés qui les réduisent. 4.1.3.
Le dividende comme moyen de surveillance et de contrôle des équipes
dirigeantes Verser
des dividendes, et de manière conséquente, permet de résoudre les problèmes
d’affectation du «cash-flow libre» c’est-à-dire du cash-flow
disponible après que toutes les opportunités d’investissement
rentables ont été saisies, et que les métiers non rentables ont été cédés
à d’autres. Cet argument milite en faveur d’une distribution élevée
dans les secteurs de faible croissance où les sociétés ont des
ressources très abondantes. De
façon générale, le versement de dividendes oblige les sociétés à
faire davantage appel aux marchés des capitaux. Ces opérations, nécessairement
peu fréquentes, sont l’occasion d’une information beaucoup plus approfondie
sur l’utilisation que la société fait des capitaux qu’elle gère. Le
dividende joue ainsi un rôle d’incitation, de surveillance et de
contrôle des dirigeants. 4.2.
La
distribution en pratique En
pratique, il n’y a pas d’égalité d’accès à l’information.
C’est parce que l’information n’est pas également répartie entre
tous les acteurs du marché et que la distribution de dividendes est une
forme coûteuse de transfert de ressources des sociétés aux
actionnaires, qu’elle peut être utilisée comme signal. Les paroles des
dirigeants sont d’autant plus crédibles qu’elles s’accompagnent
d’actions concrètes en espèces. La politique de dividendes est un
moyen privilégié de joindre l’acte à la parole. Elle est un moyen de
fidélisation de l’actionnariat face aux OPA. En
définitive, pour fixer leur dividende, les sociétés doivent tenir
compte des cinq paramètres suivants : -
le niveau passé du dividende; -
les perspectives de croissance à court et moyen terme des bénéfices
par action; -
le niveau de marge courante par rapport à la marge normale; -
le «cash-flow libre» -
la structure de l’actionnariat. Le
taux de distribution étant inversement proportionnel avec le degré de
concentration de l’actionnariat. Plus le degré est élevé, plus la
distribution est faible et inversement. En
pratique, le paiement du dividende s’opère parfois en actions. Cette
procédure permet aux sociétés d’atteindre deux objectifs
contradictoires : Panorama
de la gestion, Les
éditions d’organisation TRAVAIL
A FAIRE : Répondre
aux questions suivantes :
|
|||||||||||||||